Valeurs - Vision
et but de Christine
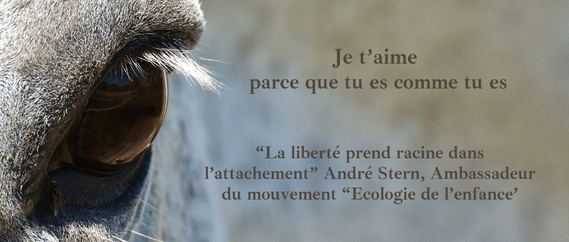
🌿 Les valeurs fondamentales de Christine
✨ L’Éthique 🤝 L’Écoute
💫 Le Respect
🌈 Sa vision de l’accompagnement
👀 Voir
Ne pas réduire une personne
à ses troubles,
mais la considérer comme
un être humain à part entière,
avec des besoins et riche de potentiels.
🧩 Les diagnostics sont des indications,
pas des étiquettes.
Ils aident à comprendre
la singularité de chacun.
👂 Écouter
Accueillir les besoins exprimés et,
surtout, le méta-besoin de sécurité 💖
🌱 Accompagner
Soutenir la personne dans
le déploiement de ses capacités,
révéler son potentiel,
tout en respectant ses limites.
🐾 Au bénéfice des deux :
Humains & Animaux
Les animaux ne sont pas des outils,
mais de véritables partenaires de vie
🐶🐴🐱.
Eux aussi ont une liberté d’expression
à écouter et à respecter 💬💚
🎯 Son but
👉 Aider la personne à sortir de son identification à un trouble.
🚫 Elle n’est pas :
une autiste, une HPI,
une dépressive, un TDAH …
Ce ne sont que des raccourcis de l’esprit,
qui enferment et nourrissent la dépendance plutôt que l’autonomie.
💎 Elle est avant tout :
Une humaine en quête de sécurité, d’épanouissement
et de liberté intérieure 🌞.
🤗 Sa mission avec les animaux :
Aller à la rencontre
du fonctionnement unique
de chaque personne,
✨ révéler ses ressources intérieures
et extérieures,
et l'accompagner, pas à pas,
dans une phase de son développement
🐕🦺Ensemble, humains et animaux.
Transmettre le chemin d'apprentissage
de l'amour inconditionnel
que lui ont appris les animaux.
Les honorer en tant qu'être sensibles
doués d'intelligence.
L'approche :
Accompagnement centré sur la personne,
par la médiation de l'animal et du jeu
La zoothérapie (ou Intervention professionnelle en médiation par l'animal) est une approche non médicamenteuse reconnue par la Haute Autorité de Santé.
Elle n'est pas une médecine et l'animal n'est ni un médicament ni un thérapeute.
Selon Résilienfance " La médiation animale est une relation d’aide à visée préventive ou thérapeutique dans laquelle un professionnel qualifié, également concerné par les humains et les animaux, introduit un animal d’accordage auprès d’un bénéficiaire. Cette relation, au moins triangulaire, vise la compréhension et la recherche des interactions accordées dans un cadre défini au sein d’un projet.
La médiation animale est donc un domaine en soi, celui des interactions Homme-Animal, au bénéfice des deux (chacun apporte ses ressources à l’autre)" (Accordage/interactions accordées : ajustement des comportements, des émotions, des affects et des rythmes d’actions. (D. Stern 1982 – 1985)
Selon François Beiger, Directeur de l'Institut Français de Zoothérapie : la zoothérapie est "une médiation qui se pratique professionnellement en individuel ou en petit groupe, à l'aide d'un animal familier consciencieusement sélectionné et éduqué sous la responsabilité d'un professionnel, l'Intervenant en médiation par l'animal. La médiation a lieu dans l'environnement immédiat de la personne chez qui l'on cherche à éveiller des réactions visant à maintenir ou améliorer son potentiel cognitif, physique, psychosocial ou affectif".
La zoothérapie met en œuvre une triangulation entre la personne bénéficiaire (avec son histoire, ses souffrances, ses besoins, ses envies et ses capacités), l'animal (avec ses caractéristiques, son éducation et sa sensibilité) et l'intervenant ou zoothérapeute (avec son savoir-faire et son savoir-être).
Christine appui sa pratique sur son expérience et l'approche humaniste centrée sur la personne de Carl R Rogers, pour lequel "Chaque individu est unique. Il détient au plus profond de lui sa propre vérité, sa vie et le tracé potentiel de son chemin ... Il peut accéder à ses ressources s'il se sent compris, accepté, non jugé".
Selon Carl R. Rogers, les ressources de l'individu sont étouffées par la perception qu'il a de lui-même et des autres.
Il imagine l'approche centrée sur la personne (relation d'aide par l'écoute active) et la définit comme "une coopération ayant pour but ultime la prise progressive de son pouvoir sur lui-même de l'aidé".
Cette coopération nécessitant que le thérapeute dispose de trois qualités, à même de relancer la tendance naturelle de l'être humain à s'auto-actualiser :
L'empathie : capacité de se mettre à la place de l'autre, à essayer de comprendre son ressenti, ses émotions, ses sentiments ;
La congruence : capacité à être authentique ;
Le regard positif inconditionnel : capacité à ne pas juger, ni évaluer l'autre, à respecter l'autre.
Christine ajoute à ces qualités, la présence : être présente pour la personne accompagnée et lui offrir un espace d'expression, à laquelle s'ajoute la présence animale qui facilite le lien, aide à la relation, joue un rôle de miroir, écoute, apaise et réconforte.
Christine utilise également dans sa pratique différentes méthodes de communication telles que :
la Communication Non-Violente - CNV® - conceptualisée par Marshall B. Rosenberg qui la définit ainsi
« Communication : le langage et les interactions qui renforcent notre aptitude à donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant ; l'empathie étant au cœur de ce processus de communication ; Non-violente : signifie communiquer avec l'autre sans lui nuire ; toujours en s’appuyant sur les besoins humains ».la Validation® - conceptualisée par Naomi Feil : « La méthode – aussi appelée Validation® affective, ou thérapie par empathie – a pour objectif principal de maintenir la communication avec les grands vieillards désorientés afin de les accompagner dans une relation respectueuse de leur identité tout en reconnaissant dans leur comportement, la manifestation de leur besoin d’exister en tant qu’individu et d’être entendus ».
la Programmation neuro-linguistique, conceptualisée par John Grinder et Richard Bandler, en ce qu'elle consiste à améliorer, faciliter et développer la communication avec soi-même et les autres et permet de comprendre comment l'autre se représente le monde.
Dans ses accompagnements, l’animal (au travers des jeux et activités proposés) est le « trait d’union » entre la personne accompagnée et elle.
L’animal capte l’attention de la personne et la focalise sur ce qui est là dans l’instant présent, il attise sa curiosité et son enthousiasme qui nourrit sa concentration, il lui fait pousser les ailes de la motivation et parce qu’il est non jugeant et en demande, il lui donne la force d’être volontaire et de faire.
L’animal connecte la personne à ses ressentis, au champ de ses émotions.
Il donne de l’affection et de l’amour de manière inconditionnelle.
Pour Christine, cet attachement qui procure une sécurité affective et émotionnelle est le point d’ancrage et la base du lien à construire, à entretenir, à protéger pour qu’ensuite le champ des possibles puisse s’ouvrir sur les capacités et plus tard sur les apprentissages qui conduiront à l'autonomie, à hauteur des capacités de chacun.
L’observation de l’interaction de la personne avec l’animal permet de voir quelles sont ses capacités, ses motivations, ses envies vis-à-vis de lui.
Le programme proposé définit les objectifs de travail sur ces fondements : stimuler les capacités existantes pour les renforcer et les développer en s’appuyant sur la motivation et les envies de la personne, afin qu'elle renoue avec son enthousiasme d'enfant.
Le travail sur les capacités intellectuelles, fonctionnelles, sensorielles et sociales préservées nourrit la confiance de la personne, la rend actrice et permet d’investir ensuite d’autres champs. L’émotion qui accompagne le moment ancre ce qui est vécu et les apprentissages abordés.
Pour Christine, l’accompagnement par la médiation de l’animal est avant tout un soin relationnel, c’est un lien de cœur à cœur qui unit la triangulation « personne-animal-zoothérapeute » et c’est à partir de ce lien qui sécurise, que la personne peut aller à la rencontre d’elle-même, qu’elle peut apprendre à se connaître, à se faire confiance, à communiquer (en verbal et/ou non verbal), à trouver des ressources et à trouver sa place dans la relation (avec elle et avec les autres).
Dans sa relation avec l'animal, la personne apprend à utiliser ses différents canaux sensoriels pour développer ses perceptions (la voix, le kinesthésique - toucher interne et externe, la vue).
Elle prend conscience que tout est toujours une affaire de perception, d'angle de vue.
En affinant et en enrichissant ses perceptions, elle développe son sens de la communication verbale et non verbale et ses moyens de se faire entendre et comprendre.
Pour pouvoir jouer avec le chien, qu'il écoute et reste attentif à elle, la personne apprend à être présente et centrée sur l'animal, elle apprend à se positionner par rapport à lui (la proxemie), elle développe ainsi ses facultés d'attention et de concentration. La personne apprend également à s'écouter et à tenir compte de ses besoins et de son rythme au travers de ses ressentis et de ses émotions, par imitation de l'animal.
Le cochons d'inde pris dans les bras ou observé sur la table permet également à la personne de développer ses perceptions et sa curiosité. Ses vocalises ou vibrations attisent et retiennent l'attention, cet animal qui renvoie à la part la plus sensible et vulnérable que l'on porte en soi, fascine et conduit la personne dans un état d'apaisement et de profond bien-être.
Le cheval doué d'une intelligence émotionnelle et relationnelle apprend à la personne à devenir congruente dans la relation avec lui et, finalement, avec elle-même.
Ce qui est important pour Christine, c’est que la personne s’accepte « comme elle est » et acquiert une confiance en elle, qu’elle prenne conscience de ses capacités, de ses talents, de la richesse qu’elle porte en elle, qu’elle apprenne à s’estimer et à s’aimer telle qu’elle est, l’animal l’aidant sur ce chemin car jamais il ne fait ni ne lui renvoie de différence.
Enfin Christine appuie sa pratique sur les fondements théoriques suivants :
La théorie de l'attachement développée par John Bowlby (1907-1990) et MDS Ainsworth (1913-1999) : l'attachement se référant à une relation proche diminuant le sentiment d'insécurité de l'enfant grâce à la présence d'un de ses parents. MDS Ainsworth a étendu cet attachement à l'ensemble des relations dérivées. La condition nécessaire de l'attachement est la baisse du sentiment d'insécurité en présence de l'objet d'attachement. Bowlby qualifie les autres types de relation affective de "lien". Les relations homme-animal seraient de ce type, les animaux ayant la faculté de faire baisser l'anxiété et donc le sentiment d'insécurité.
Comme l'enfant au premier stade de son développement, un adulte ou une personne âgée, à son stade de développement, a besoin de cet attachement, a besoin de se sentir en sécurité et de se sentir aimé.
Une personne en situation de détresse ou de vulnérabilité a besoin d'un sujet "plus sage et plus fort", la figure d'attachement.
Les réponses de ce "sujet" aux besoins de la personne contribuent au développement d'un lien d'attachement.
Les "figures d'attachement" d'un adulte ou d'une personne âgée sont les personnes sur lesquelles il s'appuie pour trouver différentes formes de soutien et de protection en cas de problèmes ou de difficultés.
La théorie du jeu développée par M. Klein et D. Winicott et André Stern : Pour eux, le jeu est l'activité la plus naturelle de l'enfant. Le jeu lui sert à s'exprimer et à rejouer des scènes, le jeu remplace la parole.
M. Klein donne un sens à toutes les étapes du jeu.
Pour D. Winicott, le jeu n'est pas seulement un moyen thérapeutique, il a des vertus thérapeutiques. Le simple fait de jouer va aider la personne qui joue. On voit bien de quelle manière l'animal peut être placé au centre du jeu. Pour D. Winicott (1971) "C'est en jouant et seulement en jouant, que l'individu, enfant ou adulte, est capable d'être créatif et d'utiliser la personnalité toute entière. C'est seulement en étant créatif que l'individu découvre le soi".
Pour André Stern, le jeu est le dispositif naturel d'apprentissage. C'est une expérience qui se vit, au travers de laquelle les dispositions spontanées de l'enfant s'expriment naturellement. Le jeu favorise la curiosité et l'enthousiasme de l'enfant et des émotions propices à l'ancrage des apprentissages.
Réservez votre visite maintenant
Nous détestons le spam. Votre adresse email est sécurisée à 100 %